Nìkos KOKÀNTZIS,
Gioconda
Traduit du grec par Michel Volkovitch.
Titre original : Tziokonta éd.Kedros, 1975.
Editions de l’Aube, 2014.
coll. « Aube Poche littérature »
ISBN 978-2-8159-0644-9
Histoire d’un rêve éveillé
« CECI EST UNE HISTOIRE VRAIE. Hier, une fois de plus, j’ai vu en rêve mon ancien quartier. »
Ainsi débute Gioconda, le récit de Nìkos Kokàntzis, écrit en 1975 et paru en France en 2014, trois ans après sa publication en Grèce. Il apparaît immédiatement comme un objet littéraire étrange. En effet, dans ce livre sous-titré « récit », le jeune narrateur, Nìkos, raconte à la première personne du singulier, son enfance passée avec une « bande » de gamins, dont sa voisine juive Gioconda, avec qui il va vivre une histoire d’amour, celle qui va leur « offri[r] l’expérience la plus bouleversante de [leur] vie » (p.96). Cette « histoire vraie », qui débute à Thessalonique en Grèce et évolue dans le contexte bien réel de l’Occupation pendant la Seconde Guerre Mondiale, prend alors une dimension autobiographique. Pourtant, on ne compte pas les références au rêve, qu’il soit idyllique ou cauchemar : du « sentiment affreux que tout cela n’était qu’une utopie, un rêve » (p.27), à Gioconda « [qui] parlait maintenant comme dans un rêve. » (p.37), jusqu’à « ce rêve dont [il] ne savai[t] pas encore qu’il allait bientôt virer au cauchemar. » (p.95). Le récit de Nìkos Kokàntzis rend constamment floues les frontières entre ce qui relève du vrai et ce qui relève de la rêverie. Comme le souligne son traducteur Michel Volkovitch, « le plus étrange c’est que cette histoire vraie, ancrée dans la réalité la plus précise, ne cesse de dériver, insensiblement, vers les territoires du rêve. Comme si à force de nous bousculer, c’était le réel lui-même qui basculait.[1] »
Le lecteur plonge dans les souvenirs de Kokàntzis, dans une histoire à la fois réelle, et hors du temps.
Écrire contre l’oubli
De Nìkos Kokàntzis, on ne sait presque rien. Entre sa naissance en 1930 à Thessalonique et sa mort en 2009, on sait seulement qu’il a étudié la médecine et la psychiatrie à Londres. Gioconda, son premier et unique récit, est le témoignage d’un monde révolu, qui n’existe plus que dans son souvenir : « Moi, au moins, je l’ai connu [le quartier] du temps de sa beauté. » (p.7). « Le terrain vague avec ses hautes herbes, ses buissons et l’odeur du thym, n’existe plus. » (p.119) et « […] tout a disparu sans laisser de traces. » (p.120). Temps révolu, personnages disparus avec lui. On apprend très vite que les voisins, les gamins avec qui il jouait petit, « étaient des juifs. » (p.10). Cette phrase, qui tombe comme une sentence et fait planer dès lors une menace tout le long du récit, nous laisse deviner immédiatement et sans détour la fin tragique. Car là n’est pas ce que veut raconter le narrateur. Le récit a avant tout été écrit pour que la mémoire de Gioconda ne meure pas avec lui. Il a aussi été écrit pour que ne meure pas la mémoire des juifs de Thessalonique qui furent tous déportés en 1943, et dont très peu sont revenus. C’est donc la petite histoire dans la grande que raconte Gioconda, pour ne pas oublier. Publié trois ans après la mort de l’auteur, il revêt à bien des égards des allures d’histoire de fantômes, des fantômes qui revivent le temps d’un récit.
L’urgence de vivre
Parce que l’on sait dès le début que le bonheur de cette histoire d’amour est éphémère, et qu’elle se terminera par une « séparation » (p.10), tout devient plus intense, et le récit se gonfle d’une tension dramatique extrême. Chaque moment est alors vécu « avec une intensité particulière » (p.42), comme s’il était le dernier, et vivre devient plus que jamais un impératif : « Il fallait que nous soyons ensemble. », « mais plus qu’un bonheur c’était un besoin », (p.14), « nous jouions avec une intensité qui croissait d’année en année, nous jouions avec une fureur, une frénésie » (p.15). À l’urgence de vivre, répond l’urgence de raconter. Le très court récit de Kokàntzis, qui ne comprend pas de chapitres et se lit d’une seule traite, est fulgurant, à l’image de l’histoire qui y est racontée. Les phrases sont parfois très longues, et les verbes d’action s’enchaînent à un rythme rapide : « Je fis un petit pas prudent vers elle, sans qu’elle disparaisse, je m’arrêtai et alors elle vint vers moi en rougissant, me prit la main, me ramena doucement vers le muret, me fit rasseoir » (p.32). À la fois simple, empreinte d’une certaine naïveté et surtout d’une très grande vitalité, l’écriture de Nìkos Kokàntzis se fait l’écho de la fureur de vivre de ces gamins qui « devin[ent] qu’il fallait faire vite, […], appelés à payer [leur] humble, insignifiante et en même temps énorme part. » (p.54).
Le corps dans tous ses états
Dans cette atmosphère menaçante et humiliante de la guerre, se côtoient les corps des morts et ceux des vivants. Car Gioconda est aussi un formidable récit du corps. « [P]arfois, le lendemain matin, quelqu’un était étendu mort dans la rue. » (p.49). Mais le narrateur raconte avant tout le corps qui vit. Le corps qui change, qui est malmené, qui est plein d’amour, qui se cherche, qui est excité, qui se dévoile, qui se dissout ou encore qui se mélange avec l’autre. Cette omniprésence du corps se double de la sollicitation des cinq sens : le toucher et la vue, par les innombrables références aux caresses et aux jeux de regards entre les jeunes amants, l’odorat (« l’odeur de la sueur et du corps » p.91), l’ouïe (« ces mille bruits infimes, qu’on devine plus qu’on ne les entend, les bruits d’une nuit paisible » p.50, l’histoire du musicien « Théo qui jouait l’adagio de la Sonate au clair de lune. » p.66), et enfin le goût (« dans le creux de l’aisselle mouillé de sueur avec son odeur et son goût » p.88). Raconter le corps, le corps vivant, sert merveilleusement l’histoire des premiers émois amoureux, mais plus encore, celle de « la grande découverte » (p.52). En effet, de manière très explicite mais toujours avec beaucoup d’élégance, le récit de Nìkos Kokàntzis raconte aussi la découverte de la sexualité. Faisant alors appel à toutes les sensations, il en devient presque organique, empreint d’une très grande sensualité, et nous fait nous sentir incroyablement vivants.
Peu importe de savoir si les événements relatés sont vrais ou pas. Car lire Gioconda c’est avant tout se plonger dans un conte initiatique bouleversant, qui repose sur le balancement entre l’enchantement de l’amour et le pressentiment d’une fin tragique. Un conte initiatique dans lequel des enfants jouent à en perdre haleine, grandissent et apprennent, peut-être trop vite, à une époque où « le seul fait de vivre […] était déjà quelque chose d’héroïque » (p.44). À travers leur histoire, Gioconda nous raconte avant tout une histoire universelle, celle « de comprendre la vie » (p.31).
[1] Postface, « Un livre hanté », p.123.
Guichet Clémence, A.S. Bibliothèques-Médiathèques, 2017-2018
Sources :
Éditions de l’Aube, http://www.editionsdelaube.fr/auteurs/nìkoskokàntzis, (consulté le 11 novembre 2017).
Biographie de l’auteur :
 |
Nationalité : Grèce Né à : Thessalonique , 1930 Mort(e) : 2009 |
Nikos Kokantzis, né à Thessalonique en 1930, découvrira l’amour avec Gioconda en 1943. Juive, celle-ci sera déportée à Auschwitz… et n’en reviendra pas. Et c’est en 1975 que Kokantzis décide de raconter leur histoire d’amour, pour que Gioconda revive à travers ses mots. C’est son premier et seul ouvrage. |

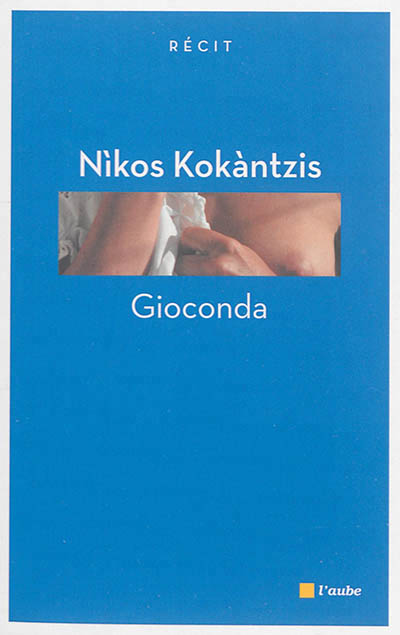
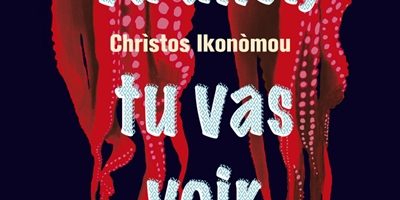
 Découvrez les critiques des derniers livres sélectionnés par les étudiants Métiers du livre de l’IUT Bordeaux Montaigne
Découvrez les critiques des derniers livres sélectionnés par les étudiants Métiers du livre de l’IUT Bordeaux Montaigne